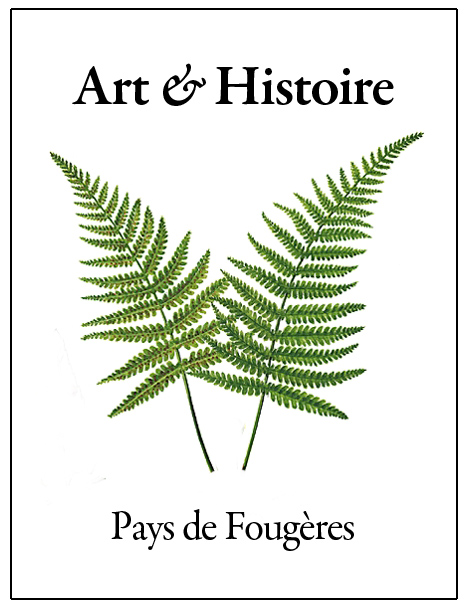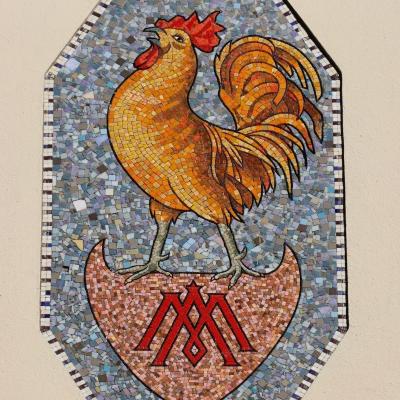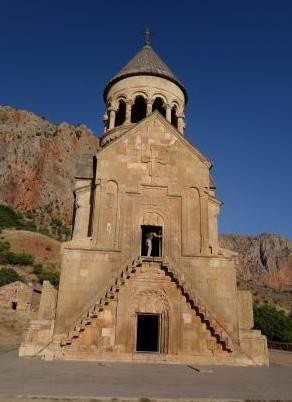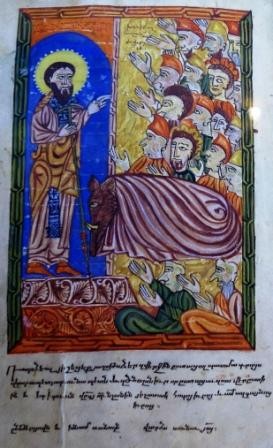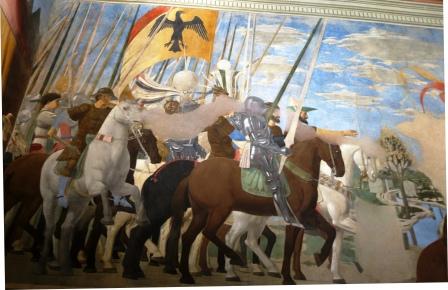galerie de sites visités au fil des années
-
FLASHES Années antérieures
SITES, Programme 2014
-
sites 2020-2022
Josselin-château-des-Rohan.jpg (2.63 Mo)

Collégiale N-D de Lamballe triforium
A Lamballe, sur les verrières gothiques de la collégiale Notre Dame, Olivier Debré et Geneviève Asse ont célébré la lumière dans un grand hymne cosmique, en voie d’achèvement après dix années de longue patience. Olivier Debré y a sollicité les modulations vives du jaune ; Geneviève Asse y déplie toute une gamme de bleus parcourus de légères ondulations, ciel du matin limpide et calme, ciel du soir virant au bleu nuit irisé de fragiles clartés, ciel embrumé des nuées lointaines, ciel de saphir, bleu ciel de l’été transparent et franc, immense voilure rythmée par des verticales rouges et blanches lancées vers l’infini. Et dans ce vaisseau de pierre amarré au granit, ces voiles jaunes et bleues incantent l’espace et le départ.

château de La Haye-Saint-Hilaire
...Le château actuel, pour sa plus grande partie, nous l’avons vu précédemment en évoquant Henri de La Haye Saint-Hilaire, date du début du XVIIème siècle. Son logis principal avec son toit à la Mansart qui repose sur une corniche à modillon, est percé d’une porte surmontée d’un fronton triangulaire. La bâtiment est flanqué d’une aile non saillante à la toiture très élancée. L’arrière du château baigne dans les eaux d’un petit étang. Le château a été construit sur un terrain marécageux. A l’occasion de travaux d’assainissement, on a mis à jour d’énormes troncs de chêne plantés en terre de manière à consolider un terre-plein sur lequel le château a pu être construit. « Le château est construit sur pilotis », nous dit le comte de La Haye Saint-Hilaire lors de notre visite, étonné et curieux de savoir comment et avec quels moyens on a pu les planter ainsi, à la verticale ! Dans la cour, un peu seule, une jolie tour de guet, de forme ronde, est un reste de l’ancien château de La Haye construit aux XIIIème et XVème siècles. Cette tour devait être intégrée avec les portes fortifiées aux fortifications projetées par Henri de La Haye-Saint-Hilaire interdites par le roi en 1619. Les communs, construits en grand appareil, occupent un côté de la cour. Ils ont été élevés avec les pierres du château primitif. Une tour carrée, dite Tour Henri IV, reste un pavillon d’angle assez énigmatique. On y trouve un départ de voûte et des corbeaux dont l’un s’ancre dans une fenêtre murée. S’agit-il d’un chemin de ronde, d’une terrasse, d’une galerie, d’un support de colombier en bois ? Nul ne le sait vraiment. En face, dans un angle de la cour, s’élève la chapelle du château dédiée à la Sainte-Famille. En pierres de granite appareillées, elle est sommée d’un campanile en ardoise. La chapelle fut construite en 1686 par Anne de La Haye-Saint-Hilaire et Louise de Canabert, son épouse. Le 14 juin de cette même année, ils y fondèrent une messe basse pour tous les dimanches et 25 messes par an lors de diverses fêtes religieuses

Douvres, chapelle Lalique
René LALIQUE et les LYS de LA DÉLIVRANDE En 1931, à l’occasion du Centenaire de la fondation de la Congrégation Notre-Dame de Fidélité, la Supérieure Générale souhaite remplacer le Crucifix en bronze doré par un grand Crucifix translucide dont le dessin sobre et dépouillé rappelle-rait la fidélité et la simplicité de la Vierge-Marie. Lalique est alors pressenti ; il connaît l’institution de la Fidélité pour avoir confié à l’Orphelinat une petite-fille. Les travaux entrepris dans la chapelle en 1929 ont fait tomber le mur qui séparait la nef du transept, l’espace est comme irra-dié. Lorsqu’il découvre toute cette lumière qui se déverse dans le sanctuaire, il est immédiatement inspiré et il propose à la Supérieure de composer un nouveau décor à thème floral en accord avec la vie religieuse : le lys. On connaît la prédilection de Lalique pour les arbres, les fleurs, les oiseaux : il cueille la nature et la transcende. Le lys, effilé, simple et beau, lui paraît le mieux convenir à exprimer la verticalité de la vie religieuse, l’aspiration à la pureté, la confiance dans la volonté divine : n’est-ce pas la fleur de l’Annonciation ? Dès 1902, Lalique s’intéresse aux virtualités décoratives du verre à l’échelle architecturale : dans son hôtel parisien du Cours-La-Reine, il conçoit déjà des portes d’entrée en dalles de verre ornées de feuillages. En novembre 1929, Lalique dé-pose un brevet d’invention pour un vitrail à armatures métal-liques et dalles de verre modulables. Après avoir esquissé ses lys, il fait réaliser les moules de fonte à Paris et lance la fabrica-tion : au Salon d’art religieux de l’automne 1930, il présente déjà son projet pour la chapelle Notre-Dame de Fidélité... Association Art et Histoire

Brocéliande, église de Tréhorenteuc , dite du Graal restaurée par l'abbé Gillard
L’ÉGLISE DU GRAAL LA COUPE D’ÉMERAUDE Dès l’entrée, une inscription énigmatique intrigue : « La porte est en dedans » et la surprise est au rendez-vous dans cette petite église ésotérique. La renommée de Tréhorenteuc doit beaucoup à la beauté du site, aux légendes qui ont éclos dans le val et au charisme de l’abbé Henri Gillard (1901-1979), nommé recteur de cette paroisse reculée en 1942 qui, au cours de ses 20 ans de présence, entreprit de lui redonner un souffle spirituel en restaurant l’église Sainte Onenne et en y introduisant le mythe christianisé de la Quête du Graal. Épris de spiritualité et de syncrétisme, le recteur voulait mettre en harmonie les mythes celtiques, la légende arthurienne et ses croyances chrétiennes : le trait d’union, c’est le Graal. Le Graal apparaît dans l’univers romanesque arthurien à la fin du XIIème siècle, chez Chrétien de Troyes auteur du Conte du Graal ; Perceval parcourt la « terre gaste » et parvient au château du Roi Pêcheur : au cours d’un banquet, il voit défiler à trois reprises une épée tachée de sang et un vase mais il n’ose pas demander ce qu’il contient et à qui il est destiné, cette négligence lui vaudra de ne pas pouvoir parachever sa quête. Le roman reste inachevé mais la recherche de l’objet magique et inaccessible devient un ressort de la littérature chevaleresque arthurienne. La Quête du Graal est proposée à la chevalerie aux mœurs rudes comme un appel au dépassement, un idéal spirituel insaisissable. Au XIIIème siècle, Robert de Boron lui donne une coloration chrétienne, le Graal est la coupe de la Cène, c’est elle qui a recueilli le sang du Christ sur la croix. (Association Art et Histoire))

Pont-Aven
PONT-AVEN, rendez-vous des artistes 10 juin 2016 « J’irai l’été prochain me mettre à l’auberge dans un trou de Bretagne faire des tableaux et vivre économiquement…. » Gauguin La Bretagne prend une place de choix dans la peinture au début du XIXe à la faveur du goût de l’Histoire et des traditions celtes mis en valeur par le mouvement romantique : paysages, fêtes et scènes de genre constituent des sujets de prédilection. Dans les années 60, Eugène Boudin, qui séjourne souvent à Douarnenez, est sensible à la lumière et aux intérieurs bretons ; il est suivi par de nombreux artistes las de Barbizon. La vogue de Pont-Aven a été lancée par les artistes américains, Henry Bacon, Robert Wylie, Charles Way : dans les années 1860, plusieurs peintres s’y retrouvent, attirés par les paysages de Bretagne, les traditions fortes, les costumes pittoresques. Quand Robert Wylie s’installe à Pont-Aven en 1865, il y trouve déjà une douzaine d’artistes dont sept Américains, deux Anglais, deux Français. La situation géographique du village, entre Quimperlé et Concarneau, l’originalité de sa petite vallée où l’Aven coule bruyamment entre les chaos rocheux, l’animation marchande entretenue par les nombreux moulins et les quais où accostent les trois mâts, tout contribue à l’attraction du site ; s’y ajoute la réputation d’accueil du village où trois hôtels ouvrent leur porte aux artistes, l’hôtel des Voyageurs, tenu par Julia Guillou qui reçoit les peintres américains et les touristes anglais , le Lion d’or où se retrouvent les Français et, pour les moins fortunés, la Pension Gloanec, renommée pour son bon marché et sa convivialité. La pension de Marie-Jeanne Gloanec, sanctuaire de Gauguin ; une plaque commémorative posée en 1939 rappelle le nom des artistes fondateurs de l’Ecole de Pont-Aven : Paul Gauguin, Emile Bernard, Charles Laval, Henri Moret, Ernest de Chamaillac, Madeleine Bernard mais plusieurs proches de Gauguin ont été oubliés. Juin 2016. Les articles de presse, les récits de voyage, la notoriété de l’américain Wylie et l’exposition posthume de ses œuvres à Paris en 1878, la venue de peintres parisiens comme Léon Germain Pelouse, paysagiste de Barbizon et l’affluence des paysagistes anglais font de Pont-Aven un pôle de la création artistique ; vers 1885, une centaine d’artistes résident à Pont-Aven. La physionomie de la bourgade change, Pont-Aven est devenue une grande ruche artistique. Julia Guillou agrandit son hôtel des Voyageurs en faisant construire l’annexe, aujourd’hui site du nouveau musée. Marie-Jeanne Gloanec acquiert l’auberge du Lion d’or, près de l’annexe de Julia Guillou. Plusieurs villageois font « chambre d’hôte » ou atelier improvisé. Les murs des auberges se tapissent d’estampes laissées en hommage ou en souvenir, comme à l’auberge du Père Ganne à Barbizon. Le journaliste Edgar Courtois évoquait en août 1885, dans des termes sans doute excessifs, l’atmosphère très particulière du village: « Pont-Aven n’est plus qu’un immense atelier de peinture en plein air. On ne peut pas faire un pas sans marcher sur un vieux tube défoncé, des raclures de palettes, sans rencontrer un morceau de papier Wathman barbouillé de couleurs. Ce n’est du matin au soir qu’une longue procession de bicycles, tricycles conduisant les peintres et les peintresses à leur travail en plein air ou dans les chaumières où ils vont peindre des intérieurs bretons. » C’est dans cette ambiance bohème qu’arrive Gauguin en juillet 1886, sur les conseils d’un ami peintre, Armand-Félix Jobbé-Duval. Pour la peinture, il a quitté son emploi d’agent de change, il vient de vendre sa collection de tableaux pour soigner son fils, sa femme Mette et ses enfants sont repartis à Copenhague. Il est à la recherche d’un nouveau langage pictural. Musée de Pont-Aven, salle à manger de l’annexe de l’hôtel Julia avec ses boiseries d’origine, autrefois décorée des estampes des artistes pensionnaires. © Juin 2016. A la pension Gloanec, Gauguin loue l’une des chambre mansardées donnant sur la place pour un prix plus que modique, il y croise les peintres Charles Laval, Ferdinand du Pingaudeau, Henri Delavallée, Henri Schuffenecker qui, comme lui, avait préféré la peinture à la finance, et quantité d’Américains . Il dessine et peint les bords de l’Aven, les bois environnants, les jeunes qui se baignent entre les chaos, les chaumières, les costumes bretons, les lavandières, de nombreuses études. La Bretagne de Pont-Aven, sa nature simple et rustique fascinent le maître. S’il quitte le village en octobre1886, il y revient en janvier 1888, après un séjour au Panama et à la Martinique : l’hiver sévit et chasse les artistes, il est malade et désargenté, pourtant il écrit à son ami Schuffenecker : « J’aime la Bretagne, j’y trouve le sauvage, le primitif ; quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j’entends le ton sourd mat et puissant que je cherche en peinture. Gauguin, Les Lavandières à Pont-Aven, 1886, 60,4 x 73,3 prêt du musée d’Orsay au nouveau musée de Pont-Aven (cl. Wikimedia) En 1886, Gauguin est encore assez proche de Pissarro. Au fil des mois, il rencontre des peintres intrigués par la nouveauté de sa démarche : Emile Jourdan, Henri Moret, Emile Bernard, une période charnière, féconde en échanges et en créations dont Vision après le sermon. Puis Gauguin rejoint Van Gogh à Arles, jusqu’à la crise de démence de ce dernier, il revient à Paris mais l’attraction bretonne reste la plus forte : au printemps 1889, il retrouve, pour la troisième fois, Pont-Aven, la pension, le manoir et l’atelier de Lezaven, Nizon, la chapelle de Trémalo, c’est l’époque du Christ Jaune, du Christ Vert, de la Belle Angèle. Au bout de quelques mois, Gauguin s’éloigne au Pouldu, où il a des admirateurs et disciples. Après un long séjour à Tahiti, Gauguin revient à Pont-Aven en mai 1894 avec sa compagne Annah et sa guenon ; il est blessé au cours d’une algarade sur le port de Concarneau et retenu de longs mois. Les tracasseries judiciaires, la perte sensible de son aura auprès de ses disciples le font regarder de nouveau vers Tahiti et les Marquises où il passe ses dernières années. Pont-Aven, entre terre et mer, entre avant-gardes et traditions, village inspiré où l’on aime flâner, imaginer, au milieu des galeries, des chaos bruyants, des moulins muets, dans les rues encore peuplées de grandes ombres et de silhouettes mystérieuses.